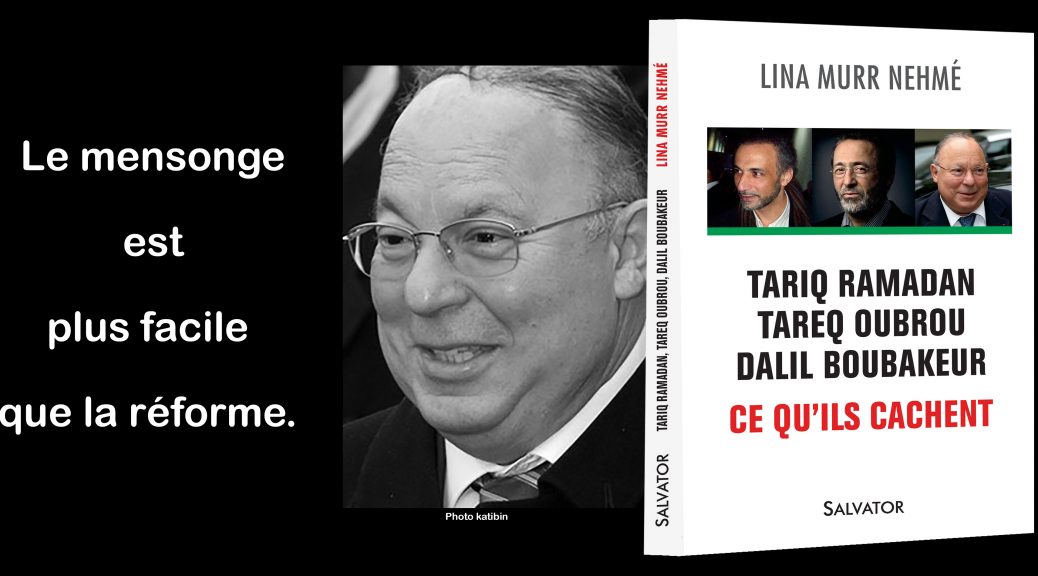Ce compte-rendu par Michel Renard (voir ci-dessous) confirme ce que nous montrait la littérature d’après-guerre, et jusqu’à la littérature de Gilbert Cesbron, qui a bien décrit le milieu des usines dans un esprit chrétien mais très à gauche. Dans cette littérature, il n’y avait généralement que des ouvriers français. Si l’on fouille dans les journaux d’époque, on trouve la même chose.
Ceux d’entre nous qui se souviennent des manifestations ouvrières à la fin des années 1970 et au début des années 1980, se rappellent que la foule était homogène, contrairement aux manifestants d’aujourd’hui. Et que le soir, dans le RER à l’heure de pointe, on voyait très peu de personnes colorées ou visiblement étrangères. Maintenant, celles-ci sont devenues la majorité. Dans la banlieue où habitaient les familles ouvrières, et où nous vivions dans un HLM à quelques mètres, non de la gare, mais de la ligne de RER, nous étions le seul couple issu de l’immigration dans tout l’immeuble. C’était également le cas entre 1982 et 1985, quand nous avons vécu à Belfort: les rares immigrés étaient des Espagnols ou des Portuguais. Les ouvriers maghrébins vivaient dans des foyers, n’ayant pas encore leurs familles.
En revanche, je n’ai vu que des étrangers à la préfecture de Nanterre lorsque M. Mitterrand, en 1981, a tenu sa promesse électorale de légaliser les sans-papiers. Ils faisaient une queue de 200 m devant la préfecture. Mais eux n’étaient pas des ouvriers à cette époque: on n’avait pas le droit de les embaucher.
Lina Murr Nehmé, 15 décembre 2018
Merci donc à Michel Renard pour l’article ci-dessous, relayé sur FB par Noam Marianne :
– “Quelle part les immigrés ont-ils prise au rétablissement de la France après 1945 ?
Dès lors qu’on veut nous persuader que les «Kabyles ont reconstruit la France», il n’est pas malvenu d’apprécier la pertinence de cette allégation à l’aune de quelques données chiffrées.
Tous les historiens de l’économie française s’accordent pour estimer qu’en 1950-1951, la France s’est relevée des destructions de la guerre. Cinq à six ans d’efforts et de sacrifices considérables ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat.
En 1951, 150 000 Algériens et moins d’une dizaine de milliers de Marocains et de Tunisiens sont en France : ces 160 000 coloniaux à supposer que tous soient des actifs – comptent alors pour moins de 1% de la population active totale.
Difficile d’admettre qu’une si faible proportion ait pu parvenir à un tel résultat !
Mais, objectera-t-on, si les ouvriers algériens sont encore peu nombreux, on ne peut nier qu’ils occupent dans l’industrie les tâches les plus difficiles, les plus dangereuses, les plus rebutantes et les moins bien rémunérées. Ils font ce que les Français ne veulent plus faire.
De ce point de vue, leur apport est donc bien indispensable, comme le directeur des établissements Francolor le reconnaît, en février 1947 : “Nous avons beaucoup de mal à trouver des ouvriers français. Cette année, les travailleurs nord-africains nous ont bien dépannés.”
Cette certitude, désormais gravée dans les Évangiles de la bien-pensance, repose pourtant sur une lecture partielle – et donc partiale – d’une réalité autrement plus complexe.
La lecture partielle se fonde sur un constat statistique : en 1952, 71% des Nord-Africains travaillant en métropole sont des manœuvres, 24% des OS et seulement 5% des ouvriers qualifiés (Rapport général de la commission de la main-d’œuvre du Commissariat général du Plan, «Revue française du travail», n° 3, 1954, p. 29).
À Renault-Billancourt, en 1954, 95% des ouvriers algériens sont manœuvres ou OS. Incontestablement, la plupart des ouvriers algériens se situent donc bien aux échelons les plus bas de la hiérarchie ouvrière.
Mais, de partielle, la lecture devient partiale, dès lors que, de ce constat, on glisse vers l’idée qu’ils se substitueraient systématiquement aux Français désormais absents de ces postes, c’est-à-dire que le monde des manœuvres et des OS serait essentiellement peuplé de travailleurs coloniaux.
Or, si l’on observe l’origine des ouvriers qui occupent ces emplois, on trouve d’abord des ouvriers français, puis des ouvriers italiens, belges, espagnols, polonais, etc., qui, sur ce plan, partagent le sort de leurs camarades nord-africains.
Renault-Billancourt, premier employeur d’Algériens, occupe 19 000 manœuvres et OS au début des années 1950. Sur ce total, 3 200 sont nord-africains, soit moins de 17% (cf. thèse de Laure Pitti, «Ouvriers algériens à Boulogne-Billancourt», 2002).
Autrement dit, les quatre cinquièmes des ouvriers les plus humbles de Billancourt ne viennent pas d’Afrique, mais des régions de France et des pays voisins d’Europe.
Sans mésestimer l’apport de la main d’œuvre coloniale à l’entreprise de reconstruction, affirmer qu’elle a joué un rôle décisif à cette occasion n’est pas seulement excessif.
À ce niveau d’exagération, c’est de fable – ou de mensonge – qu’il faut parler ! Après la Seconde Guerre mondiale comme à l’issue de la Grande Guerre, la main-d’œuvre coloniale n’a pas eu l’importance numérique et donc économique qu’on lui accorde généralement. Son rôle dans le relèvement national est même marginal – ce qui ne veut pas dire inutile – et une autre politique migratoire aurait pu, sans difficulté, pallier son absence.”
Daniel Lefeuvre, «Pour en finir avec la repentance coloniale», Flammarion, 2006, p. 154-157.